La demeure de Jules
« O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux »
Paul Valéry
Jules a choisi le Quartier-Haut. Un endroit calme, à
l’écart de la ville. Depuis le centre, il est facile de s’y
rendre à pied. Il suffit de grimper à flanc de coteau.
L’endroit n’est pas triste, ni austère, il est sérieux. Il a
la distinction et le charme d’un aristocrate.
Élégant, planté d’arbres, d’arbrisseaux et de fleurs, le
soleil écrase ses pierres, à les fendre. Incongrus, un
chemin goudronné et deux murs de béton l’isolent du
Quartier-Bas, en terrasses comme lui. Situé au-dessus
de son jumeau, il ne le domine pas.
Ainsi Jules demeure-t-il face à la mer, au-dessus d’un
semis de villas ou de jeunes immeubles. Là où des
parfums de résineux ou de lauriers volent jusqu’au
phare et la chapelle de la Vierge. Il ne se lasse pas du
panorama. La mer, vaste et lumineuse, attire au loin
son regard qu’il tourne vers ses rêves d’antan.
Jules se font dans le paysage : lorsqu’on lui rend visite,
deux ou trois fois l’an, on le devine à l’ombre d’un
cyprès, sous un olivier ou le feuillage odorant d’un
figuier ; à moins de l’apercevoir au loin, voile blanche
sous le vent, gonflé de vie.
Il y est l’ombre de lui-même, épanouie.
On le trouve en veille, tôt le matin, les jours où l’aube
embrase le coeur de ville. Il ne manque jamais le
lever du soleil sur l’horizon. Il guette sur la mer les
flaques rouge sang qu’étale la saignée des bateaux,
tremblantes sous la houle et le froid. Il salue leur
corps liquide que tranchent les étraves. Jules leur fait
face, debout, chapeau à la main. Silence. Sa clarinette
sonne : « Aux Morts ! ».
À l’ouest du mont Saint-Clair, une bande d’alluvions
fait la loi. Elle arrache à la mer nourricière l’étang
né de ses entrailles et ensable l’ancien relief qu’elle
soulève au beau milieu des eaux. De l’autre côté de la
colline, au nord, Jules plonge l’oeil dans le bassin de
Thau, retrouve Pointe-Courte qu’il fréquenta, jeune.
Sans un regard pour ce village au loin, du côté d’Adge,
où il fut si malheureux quand l’heure fut venue.
 Gros cétacé échoué là, sur la lagune, « Cette » est une
île. Il y a son refuge. Il n’écrit jamais « Sète », mais
« Cette », à l’ancienne.
Gros cétacé échoué là, sur la lagune, « Cette » est une
île. Il y a son refuge. Il n’écrit jamais « Sète », mais
« Cette », à l’ancienne.
Enfant, il s’attristait que l’étang se fût ainsi séparé
de la mer. On lui avait fait un conte de cette venue
au monde. La fée y ressemblait au Père éternel. Lui
n’y voyait qu’arrachement. Ou divorce, un mot qu’il
connaissait d’on ne sait où – jamais sa famille ne le
prononçait – et qui cachait une chose inconnue qu’il
devinait grave.
Pire, un abandon, croyait le petit Jules. Lui qui, adulte,
abandonnerait tant et se sentirait tant abandonné.
L’étang gardait de sa mer le sel et le goût des tempêtes.
Il vivait sous la brise, assoupi dans la canicule ou figé
dans le froid hivernal. Il cachait sa violence. Que la
tempête grondât, il jetait des vagues d’écume et de
rage à l’assaut du ciel, pour le crever. Lequel lâchait
sur lui ses trombes. Ils s’éventraient l’un l’autre, corps
à corps, à grands coups de lames, dans le hurlement
des flots et des grains. Leur guerre était à mort.
 Tout petit, Jules avait peur des furies de l’étang. La
nuit qui les suivait, son sommeil s’agitait. Ces luttes
de titans l’enfermaient dans un univers sombre et
inquiétant. Elles alimentaient ses propres colères, ses
cris ou ses caprices où l’on ne sut lire la peur. Son
éducation aimante et sévère, n’empêchait pas ces
« comédies » de l’enfant gâté qu’il n’était pas… Petit-
Jules était bien élevé. Souriant, gracieux et espiègle, sa
nature paisible faisait recette. Il était pacifique et doux.
Rien n’annonçait ses brèves explosions d’humeur. Nul
n’en savait le comment ni le pourquoi. Mais la poigne
de l’entourage les contrôlait. Il n’en restait rien jusqu’à
la suivante.
Tout petit, Jules avait peur des furies de l’étang. La
nuit qui les suivait, son sommeil s’agitait. Ces luttes
de titans l’enfermaient dans un univers sombre et
inquiétant. Elles alimentaient ses propres colères, ses
cris ou ses caprices où l’on ne sut lire la peur. Son
éducation aimante et sévère, n’empêchait pas ces
« comédies » de l’enfant gâté qu’il n’était pas… Petit-
Jules était bien élevé. Souriant, gracieux et espiègle, sa
nature paisible faisait recette. Il était pacifique et doux.
Rien n’annonçait ses brèves explosions d’humeur. Nul
n’en savait le comment ni le pourquoi. Mais la poigne
de l’entourage les contrôlait. Il n’en restait rien jusqu’à
la suivante.
Après la tempête, se souvient-il, l’étang, soudain
immobile, et l’air suspendu, se taisaient. Surgissait
le mistral qui poussait les nuages. Le soleil éclatait
comme un obus, transperçant le ciel nu mais à vif.
Petit-Jules souriait au beau fixe, son caprice était
retombé. Au Quartier-Haut, Jules goûte encore ce
calme après l’orage, comme il aima le bien-être
suivant chacune des migraines qui le torturèrent sa vie
entière.
Enfant, il était joyeux, on le jugea soupe au lait.
Adolescent, on le dira tortueux. Adulte, on le verrait
rongé de mauvais rêves.
Sa famille ne chercha pas elle-même ce qui
tourmentait l’enfant. Elle le confia au prêtre, voulut
savoir, n’obtint rien du confesseur. Ses soeurs le
couvraient, à elles il parlait : elles n’apprirent rien
non plus. Lui-même n’identifiait ni son trouble ni son
origine, peut-être le combat de l’étang et du ciel, sans
qu’il comprît pourquoi. Non plus que le directeur
de conscience, qu’à dix-sept ans on lui choisit. Il
le garda un an et perdit la foi. Il fréquentait encore
la paroisse de ses parents, pour ne pas les heurter.
Des Italiens sans le sou y parlaient ce napolitain qui
les tenait à distance. En dépit des efforts du curé
apprenant leur dialecte, ou les leurs s’essayant au
français, leur ardeur à vivre et leurs habitudes les
laissaient entre eux ; on ne se mélangeait pas. De
bons catholiques les saluaient en sortant de la messe,
jamais ne s’attardaient. Jules, lui, s’arrêtait. « Les
Capétiens ayant régné sur Naples, disait-il, ce sont des
Français par l’Histoire » : un raisonnement qui irritait
ses amis et amusait sa famille, attachée aux Bourbons.
Il les approcha donc. Il avait dix-huit ans. La femme
d’un pêcheur amalfitain, installé à Pointe-Courte, lui
tourna la tête. Elle l’aimantait, il la pressa. Au bord de
céder, elle le fuit. Jules souffrit puis oublia. Il se lassa
des Italiens.
Ce fut la première blessure, après ses furies d’enfant.
Dès lors, bien qu’il pût s’emporter contre des idées,
il se montrait calme face à qui les portait. Ses colères
n’étaient plus qu’agacements ou rages intérieures.
Elles n’altéraient ni sa courtoisie ni sa correction qui
rendaient exquise la moindre de ses piques. Il débitait
son mécontentement en phrases sèches, adoucies
d’une pirouette. Il n’élevait pas le ton. Un trait d’esprit
aiguisait ses mots coupants. On était loin de ses ires
enfantines.
Au-delà de l’étang, les collines s’enhardissent jusqu’au
Larzac, desséchées au vent du nord ou ravinées sous
la pluie poussée par « le Grec », venu de la mer. Des
oliviers bordent les villages resserrés sous le soleil
d’été ou la bise hivernale. Les coteaux des bords de
l’Hérault les éparpillent parmi les vignes.
De son promontoire, Jules veille sur les ceps familiaux,
au loin. Et autour de lui, à les toucher, sur ces
constructions planes ou ces chapelles minuscules, de
pierres et de croix, de fleurs et d’ex-voto, certaines
bâties par son père, enchevêtrées sur les terrasses du
Quartier-haut.
Il ne quitte plus sa résidence : terre, eau, soleil,
sécheresse, le vent, les orages, l’y retiennent. Seul son
esprit file au coeur de la cité. Il y descend chaque jour.
À ses visiteurs, depuis le phare, il montre Cette, son
royaume, à ses pieds et le raconte.
« Je flâne le long du canal comme dans ma
jeunesse, une tranchée qui fend la ville de part en
part, nourricière. J’en connus d’autres, tueuses,
qu’abreuvait la mort. Ici les quais sont pacifiques,
ils ne s’affrontent pas. Cette artère vivante ne divise
pas la ville, elle la rassemble. L’alimente et la baigne
d’eaux salines. Ce cordon ombilical, resté attaché à
sa mer, abreuve l’étang et oxygène la ville. Le retour
manqué d’un pêcheur perdu en mer, d’un marin
envoûté par l’Orient ou d’un soldat mort à la guerre,
y déverse les larmes de la cité. Moi je pleure mes amis
tués au front.
« Sur les berges, la vie est simple. Cette n’est pas
Venise : pas de palais, pas de luxe, ni intrigues ni
courtisanes. Les joutes politiques se font à coups de
gueule, pas à la dague. On ne s’embroche pas, les
couteaux restent en poche ; ils ouvriront les huîtres.
 « Je flâne parmi les filets fraîchement tirés, encore
humides, ou d’autres à l’abandon. À la criée, sous les
embruns, je m’enivre de bouffées d’iode, au retour des
chalutiers. Ils ramènent la marée et des essaims de
mouettes virevoltant jusqu’au quai. Ces gloutonnes
foncent sur leurs proies, enivrées du vacarme de leurs
cris. Leur bec sanguinaire lacère la rivale, lui dérobe
sa victime, frétillant encore et l’éventre. Je crains le
sang, j’abhorre les bagarres, je détestais celles de mon
enfance. Je fuyais. J’abandonnais la partie. Lâche ?
Pas même : je savais avoir le dessus. Je haïssais ces
violences. J’eus horreur de celles de ma guerre.
« Des poissons demi-vivants s’agitent dans les bacs.
Asphyxiés, gueule et ouïes grandes ouvertes, leurs
yeux se gonflent de terreur. Ils s’éteignent dans des
soubresauts pathétiques, parmi les éclairs du soleil sur
leurs écailles. Poissons morts-vivants, entassés comme
s’empilent à la bataille cadavres et blessés gagnés par
la Camarde.
« Je flâne parmi les filets fraîchement tirés, encore
humides, ou d’autres à l’abandon. À la criée, sous les
embruns, je m’enivre de bouffées d’iode, au retour des
chalutiers. Ils ramènent la marée et des essaims de
mouettes virevoltant jusqu’au quai. Ces gloutonnes
foncent sur leurs proies, enivrées du vacarme de leurs
cris. Leur bec sanguinaire lacère la rivale, lui dérobe
sa victime, frétillant encore et l’éventre. Je crains le
sang, j’abhorre les bagarres, je détestais celles de mon
enfance. Je fuyais. J’abandonnais la partie. Lâche ?
Pas même : je savais avoir le dessus. Je haïssais ces
violences. J’eus horreur de celles de ma guerre.
« Des poissons demi-vivants s’agitent dans les bacs.
Asphyxiés, gueule et ouïes grandes ouvertes, leurs
yeux se gonflent de terreur. Ils s’éteignent dans des
soubresauts pathétiques, parmi les éclairs du soleil sur
leurs écailles. Poissons morts-vivants, entassés comme
s’empilent à la bataille cadavres et blessés gagnés par
la Camarde.
« Quand j’étais enfant, la mort féroce des poissons
m’ensorcelait. Je recherchais ces agonies pour mieux
leur échapper, y revenant, aussitôt les fuyant. Fasciné,
terrifié, l’effroi contre l’attrait. J’acceptais cette
souffrance comme la douleur que je m’inflige, à me
mordre au sang, pour masquer sous mon crâne chaque
migraine qui m’assomme.
« Les seules luttes que j’observe, désormais, du haut
de mon belvédère, sont, sur le canal, les joutes de la
Saint-Louis. Je ne les manque jamais.
« Les jours de vent marin, des relents poisseux et
forts m’apportent les senteurs d’Orient de mes rêves
d’enfant. De gros nuages bas fondent sur la cité,
adoucie comme un loukoum. Col marin et souliers
vernis, j’échappe à ma mère. Je cours vers le port où
s’alignent des vapeurs, des trois-mâts, des bricks,
chargés d’ors et d’épices, de bois précieux, d’étoffes ou
de vin. Assis sur le ponton près d’une goélette, l’oeil
mi-clos, je file à Singapour, Valparaiso, Bangkok ou
Sydney. Pondichéry, Chandernagor, Karika, Yanaon
et Mahé, que je récite aux Bons Pères, me saoulent de
leurs parfums ; leur cohue m’entraîne, je flotte.
Ces élégants ont disparu des vieux quais. Je regrette
ces vaisseaux de poète. Ils durent laisser place à des
cargos d’acier. Venus de ports froids et automatisés,
ces monstres, ces modernes ne relâchent plus à Cette.
Ils la désertent. Des grues à l’abandon, squelettes
de ferraille et de rouille, grincent sur les docks vides,
fossiles de la splendeur passée.
On ne rêve plus dans ce havre mort, on meurt ».
Jules vint au monde dans une des rues étroites et
colorées qui descendent au canal. Des balcons où
sèche le linge, on s’interpellait en occitan, français,
italien, portugais ou espagnol, arabe et berbère. Sète
se voulait Tanger. Entrepreneurs en bâtiment, poussés
par leurs vignes au négoce des vins, ses parents
habitaient une demeure bourgeoise, abritée de hautes
persiennes aux lattes vertes illuminant la façade
dorée. Ils aimaient leur ville, et Dieu qu’ils craignaient
par-dessous tout.
Lui n’en avait cure. Il avait fait Verdun, un mariage
arrangé et de mauvaises affaires.
Il partit en Quatorze pour en découdre. Ce serait
rapide, avant l’hiver il serait de retour. Il revint en
effet. Quatre ans plus tard. Horrifié. Désespérant de
l’espèce humaine jusqu’à la fin de sa vie. Le Chemindes-
Dames – joli patronyme pour tant de cruauté
– au premier jour, tua le mari de Louise, sa soeur
préférée. Elle pleura, éleva ses trois enfants, jamais ne
se plaignit. Quelle importance, ce chagrin ? Son regard
pétillait. Sa vie durant elle garda ce sourire humble,
presque angélique, qui cachait des rides précoces. Elle
le perdit à peine lorsqu’elle mourut, cinquante ans
plus tard, en paix avec elle-même. Il demeura sur ses
lèves fines, maintenant décolorées. Contre le Ciel elle
n’eut jamais un mot. Elle consolait les autres et Jules.
Il avait changé. À cause de la guerre, comme les
autres, disait-on. Son caractère n’était plus le
même. Lui, si affable, jovial et chaleureux, subissait
maintenant la peur par bouffées, sans raison
ou pour un rien, dans la journée ou pire, la nuit.
Elles le réveillaient. Agité, couvert de sueurs, son
coeur s’emballait. Elles lui tordaient la poitrine. Il
ne se rendormait qu’au petit matin. Capricieuses,
imprévisibles, il n’avait pas moyen de les fuir ou de les
arrêter. Il lui arrivait de se voir dans un état second,
rêve ou cauchemar, il l’ignorait.
Il prit plus tard l’habitude d’absorber un alcool qui
le rassérénait, quitte à doubler la dose. Un apéritif
pouvait suffire, ou un verre de vin qui rosissaient ses
pommettes et lui rendaient le sourire ou de sa bonne
humeur passée.
On lui trouvait le caractère instable ou mauvais, c’était
nouveau, lui, jusque-là si courtois, calme et pacifique.
Cette surprise dénonçait la guerre, qui s’en souciait ?
Ses accès d’humeur déconcertaient son entourage.
Il lui fallut augmenter les prises.
Ses colères revenaient à propos de tout. Elles
rappelaient à ses soeurs celles de l’étang, lorsqu’il était
enfant, disparues avec l’adolescence. Elles invoquaient
cette fois son ménage malheureux : malgré des qualités
d’une rare humanité, sa bigote de femme, Joséphine,
ne le comprenait pas. Elle lui préférait la messe et les
mathématiques. Il avait des moments de prostration,
contrastant avec de longues périodes où il était
irritable ou étonnamment euphorique. Un beau-frère
qui ne l’aimait pas, le disait « d’humeur égale, oui,
mais mauvaise » : c’est faux. Il savait se montrer jovial
et chaleureux, mais très vite revenait l’anxiété.
Cote 304, mai 1916, on se bat corps à corps, à la
baïonnette.
Le visage du Prussien qu’il embrocha – c’était lui ou
l’autre – avait ses yeux grands ouverts, hébétés, l’effroi
aux lèvres. Leurs armes s’étaient croisées. Jules fut le
plus rapide.
 Sur le coup, il ne sentit ni frayeur ni angoisse. Sa
tête soudain était vide. Il était comme gelé sur place,
momifié ; une statue bouche ouverte dont ne sortait
nul cri, pas un mot. L’effroi. Seul au milieu de la
furie, il n’entendait rien ni personne. Il n’avait pas
conscience d’avoir vu la mort qu’il avait donnée,
ni celle qu’il eût dû recevoir. Un brancardier, lui
raconta-t-on, l’avait conduit, semi-évanoui ou hébété,
au poste de secours. Il y resta quelques heures, on
l’y réconforta. Il était calme et fatigué. Dans cette
promiscuité des morts, des blessés, des soignants,
entassés dans la gadoue parmi des rats, il se sentait
ailleurs et même étranger. Il se voyait comme sorti
de lui-même. S’observant froidement, comme il le
faisait du lieu et des camarades autour de lui, avec
une indifférence ou une objectivité exagérée, ne
manifestant nulle inquiétude de cette distance ou de
cet environnement glacé. Il était « autre ». Le décor
était d’un théâtre, il était spectateur ; rien de réel à tout
ceci.
Sur le coup, il ne sentit ni frayeur ni angoisse. Sa
tête soudain était vide. Il était comme gelé sur place,
momifié ; une statue bouche ouverte dont ne sortait
nul cri, pas un mot. L’effroi. Seul au milieu de la
furie, il n’entendait rien ni personne. Il n’avait pas
conscience d’avoir vu la mort qu’il avait donnée,
ni celle qu’il eût dû recevoir. Un brancardier, lui
raconta-t-on, l’avait conduit, semi-évanoui ou hébété,
au poste de secours. Il y resta quelques heures, on
l’y réconforta. Il était calme et fatigué. Dans cette
promiscuité des morts, des blessés, des soignants,
entassés dans la gadoue parmi des rats, il se sentait
ailleurs et même étranger. Il se voyait comme sorti
de lui-même. S’observant froidement, comme il le
faisait du lieu et des camarades autour de lui, avec
une indifférence ou une objectivité exagérée, ne
manifestant nulle inquiétude de cette distance ou de
cet environnement glacé. Il était « autre ». Le décor
était d’un théâtre, il était spectateur ; rien de réel à tout
ceci.
Cet ailleurs ne dura pas. Non plus que l’illusion de
n’être pas lui. Il reprit ses esprits et rentra sous sa
carapace. Il parla. But un café chaud, une rasade de
vin, prit son fusil et retourna au feu.
Jamais il ne raconta cet épisode. Effacé. Volatilisé. Il
n’y songea pas jusqu’à la fin de la guerre. Pas même
après sa démobilisation, à Sète, en janvier 1919. Des
années passèrent dans l’oubli total.
Il restait chez lui ou au bureau, quand il en avait un ;
il en changea maintes fois. Il travaillait pour quelques
contacts ou clients, les quittait tout à tour. Ou eux
l’abandonnaient, le désespérant davantage. Pour
s’occuper, il faisait la cuisine quotidienne, peaufinait
celle des invités du dimanche soir. Il aimait cela et
n’y manquait pas. Là au moins, il ne baissait pas
les bras, il gardait son poste. Mais c’était Joséphine,
piètre cuisinière, qui faisait bouillir la marmite. Il avait
honte de lui, de ses peurs, de ses crises d’angoisse,
de sa situation sociale – pas d’emploi, ou instable –
et de sa dépendance matrimoniale. Il désignait les
coupables, les fauteurs de guerre – mais y croyait-il
seulement ? – oubliant qu’en Quatorze, il leur était
de leur bord ; l’assassinat de Jaurès l’avait à peine
troublé. Il incriminait quiconque, en affaires ou en
privé, s’opposait à son unique idée : interdisons la
guerre. Il lui fallait des boucs émissaires. Au fond de
lui, n’en révélant rien, il s’accusait bel et bien d’avoir
tué l’Allemand : alors il buvait, trinquait « à sa santé »,
ironisait-il.
Au fil des années, sa tristesse grandissait. Il manquait
d’entrain, le matin surtout. La force physique lui
faisait défaut. Il peinait à monter ses deux étages,
sans que le médecin ne décelât quoi que ce fût pour
l’expliquer, sauf, bien plus tard, dans la vieillesse, le
coeur qui s’essoufflait. Son humeur était morose. Il
n’avait envie de rien. Sa mémoire, sa concentration
sur la lecture, étaient moins performantes que par
le passé. Pourtant cet homme cultivé s’astreignait
à lire de l’Histoire, sa passion. Il détestait le roman
et les romanciers contemporains, les Gide ou autres
Martin du Gard, bien que le jeune Brasillach trouvât
grâce à ses yeux. « Depuis Barrès, on n’écrivait plus
en France », disait-il. Quant à Proust, il l’ennuyait, à
force de phrases sans fin décrivant un monde qui ne le
faisait pas rêver.
 Après les dix ou douze premières années de son
mariage célébré en 1920 – il avait trente-huit ans – ses
nuits commencèrent d’être perturbées. Il se faisait
devoir de rester près de sa femme qui préparait ses
cours ou corrigeait ses copies, tard, dans leur chambre,
à sa table-bureau. Lui se couchait et déchiffrait
une partition ou lisait. Souvent il somnolait ou
s’endormait. Dans cette chambre où ils s’ignoraient,
elle corrigeant, lui, n’attendant rien, deux époux se
côtoyaient sans intimité.
Après les dix ou douze premières années de son
mariage célébré en 1920 – il avait trente-huit ans – ses
nuits commencèrent d’être perturbées. Il se faisait
devoir de rester près de sa femme qui préparait ses
cours ou corrigeait ses copies, tard, dans leur chambre,
à sa table-bureau. Lui se couchait et déchiffrait
une partition ou lisait. Souvent il somnolait ou
s’endormait. Dans cette chambre où ils s’ignoraient,
elle corrigeant, lui, n’attendant rien, deux époux se
côtoyaient sans intimité.
Un soir, le grincement de la plume sur une copie
déclencha le premier cauchemar qu’il fit du drame
oublié. Dès lors, l’effroi du Prussien resurgirait en
boucle, perçant son sommeil jusqu’à la douleur,
pendant des années et des années.
Il se voyait arc-bouté sur sa cuisse gauche, glissée
entre celles de l’Allemand, penché sur le malheureux
qui fit un pas en arrière, Mauser à la main, baïonnette
en place. Lui tenait son fusil à deux mains, comme
une fourche, droit devant de lui, poussait sur sa jambe
droite, embrochait son ennemi. Il crut voir dans la
pénombre, sortant du col dégrafé de l’uniforme de
son Allemand, pendant à son cou et lui jetant un
éclair lumineux, l’Étoile de David. Lui était sauf, la
manche de sa capote déchirée par la lame adverse. Il
réentendait à chaque épisode, comme la craie sur le
tableau noir ou la plume sur la copie, le crissement de
la baïonnette, lorsqu’il la retira, sanglante, du corps
qui s’affaissait. La nuit, ce déclic récurrent, un éclair,
déclenchait chaque passage du film. Une fois de plus,
il revivait la scène, point par point. Chaque détail,
fût-ce le plus insignifiant, revenait intact, augmentant
son angoisse. Et parfois, quand il y repensait dans le
calme, il l’intriguait, tant ces réminiscences si précises
étaient étranges, après tout ce temps. Il se réveillait
en sueur, bouleversé, des palpitations au coeur, les
extrémités glacées, assis soudain sur le lit, perdu au
milieu du champ de bataille. Il lui arrivait de hurler. Sa
femme n’entendait rien, elle était sourde.
Il revivait parfois la scène en plein jour : une fois
qu’il était vieux, chez le cordonnier voisin, à partager
un verre, le chuintement du couteau sur la semelle
provoqua la vision obsédante. Il connut alors la vive
épouvante de se voir dédoublé dans le temps : il
était à la fois dans le drame de l’époque et dans
l’atelier du jour, sentant le cuir et la colle ou la poix et
respirant l’odeur de poudre et de cadavre. Ce n’était
pas la première fois, il y en eut d’autres des décennies
durant. Il craignait de perdre la raison.
Son irritabilité, quelques gestes violents – il cassait
beaucoup –, ne faisaient qu’inquiéter l’entourage
voulant y lire l’empreinte de l’alcool, qu’il eût bu
ou non. Il fuyait la foule à toutes jambes, rasait les
murs, les yeux baissés. Sa honte se lisait à ces lunettes
noires qu’il chaussait sans soleil, ou à sa silhouette
soumise qui rentrait les épaules et courbait l’échine,
sans que s’affaissât jamais l’inquiétude qui le minait.
Soumis à ses craintes et aux obstacles de sa vie, il
n’y a que lorsqu’il chancelait, après le bistrot, qu’il
se sentait libéré. Il n’avait plus peur : un jour qu’il
se cramponnait à la rambarde d’un pont, le pas mal
assuré, il rit avec un mépris souverain, un sarcasme
grinçant, à la leçon minable que lui faisait un proche
qu’il croisait : après l’engueulade, cette bonne âme le
planta là et le laissa affronter seul le carrefour voisin et
encombré ; puis le jugement de sa femme inquiète de
ne le point savoir rentré.
Pour prévenir les cauchemars, il modifiait l’horaire
de son coucher, la qualité de son dîner, allongeait ses
promenades de l’après-midi qu’il finissait au café.
Toujours sans succès. Rien n’y faisait. Les soirs qu’il
avait voulu boire davantage que de raison, au grand
dam de Joséphine, il se retrouvait encore au fond du
regard ahuri de l’Allemand, le mal de tête en plus et
le lendemain, un malaise qui le rendait agressif. La
colère le prenait pour une broutille ou une réponse
inadaptée de l’épouse indignée. Puis elle retombait,
disparaissant jusqu’à l’épisode suivant.
Le cauchemar de la mort par lui infligée, lui faisait
maintenant espérer la sienne qu’il avait empêchée.
Pour en finir. Pas comme punition de son acte. Il lui
arrivait de courir des risques impensables : traverser
une route fréquentée ou la voie ferrée voisine, en
toute connaissance. Non par défi, plutôt pour s’en
remettre au hasard qui déciderait de le faire mourir
ou non. Il était obnubilé, fasciné par cette mort qu’il
s’était évitée en la donnant à l’autre. Comme celle des
poissons sur le quai, quand il était enfant, elle l’attirait
en l’effrayant.
Maintenant il souhaitait sa propre mort pour échapper
à son Allemand. Alors il se trouvait absurde et
s’enfonçait dans le désarroi : étrange ambiguïté que
son rapport à la mort.
Jamais il n’avoua son envie de se tuer. Il avait trop
honte. Pas même au médecin de famille qui parlait
de neurasthénie et prescrivait du repos au bon air. Il
la repoussait, lui échappait, y repensait. Elle venait,
il la chassait. Son éducation proscrivait le suicide.
L’épouvante de sa famille face à ce crime, s’il y cédait,
ébranlait sa conviction. L’alcool la lui faisait oublier
mais le tuait à petit feu.
 Son envie de mourir le maintint en vie. Comme s’il
préférait affronter l’horreur de son cauchemar, quitte
à ce que sa répétition le submergeât ou qu’il la noyât
dans la boisson. Cet effroi du soldat allemand, son
regard incrédule qui interrogeait le sien quand lui,
Jules, enfonçait sa lame, passait en boucle. Mais de
son propre effroi lors du corps à corps, il ne gardait
que le souvenir d’un blanc aveuglant.
Son envie de mourir le maintint en vie. Comme s’il
préférait affronter l’horreur de son cauchemar, quitte
à ce que sa répétition le submergeât ou qu’il la noyât
dans la boisson. Cet effroi du soldat allemand, son
regard incrédule qui interrogeait le sien quand lui,
Jules, enfonçait sa lame, passait en boucle. Mais de
son propre effroi lors du corps à corps, il ne gardait
que le souvenir d’un blanc aveuglant.
Il n’en parla jamais. Sauf une fois à son frère, après la
démobilisation. Il ne racontait pas sa guerre, pas plus
que les autres ne disaient la leur. Il fallut quelques
témoignages au fil du temps, recoupant de vagues
allusions, pour qu’il se livrât et qu’enfin on sût ce qui
le hantait.
C’était à la fin de sa vie.
Alors le vit-on pleurer sur son Allemand. À moins que
ce ne fût sur lui-même.
La musique et sa fille unique, son soutien face à
Joséphine, le soutenaient contre les malentendus
conjugaux et des affairistes véreux.
Il s’était lancé dans le courtage en vins, comme on
se jette à l’eau, espérant nager sans avoir appris. Il
ne connaissait rien au commerce. Puis il fut quelques
mois, quelques années peut-être, représentant en
alcools et spiritueux, sillonnant les routes glacées de
Meuse et de Meurthe-et-Moselle, ou jusque dans les
Vosges. Il n’allait pas en Moselle, jamais à Metz, qu’il
trouvait trop prussienne bien qu’il sût – 1552 – la
date de son rattachement forcé à la France, avec Toul
et Verdun ; l’annexion de 1871 puis la guerre et cet
Allemand mort de sa main, lui barraient les chemins
de Moselle.
Il reprit le courtage en vins, s’essaya à d’autres
emplois, multiples et sans substrat. Il eut de longues
périodes d’inactivité, sa vie durant. Ce qu’il préféra,
ce fut l’époque où il essayait de placer les vins de
sa famille et d’autres crus plus renommés, dans
ses premières années en Lorraine. Il ne faisait pas
encore ces drôles de cauchemars. Le souvenir de
Verdun, toutefois, ne le lâchait pas. Il s’y rendait
avec sa Citroën, deux ou trois fois l’an, lors de
ses démarchages. Moins de deux heures de route
par Saint-Mihiel et la Voie sacrée, depuis Toul où
Joséphine enseignait au lycée de jeunes filles.
Une fois, quand son sommeil commençait d’être
perturbé par ses terreurs nocturnes, entre deux
verres de gris de Toul, ce vin « pierre à fusil » dont
il appréciait l’âpreté et l’acidité si différentes de la
verdeur des siens à Sète, il acheta une brasserie avec
un associé rencontré au bistrot ; ils firent faillite.
Dès la signature de l’acte, l’idée de l’échec lui était
apparue, il fut incapable de faire marche arrière. Dans
la débâcle de ses finances, de brèves colères mettaient
sa moustache en bataille, il revoyait ses tempêtes
de l’étang de Thau. Alors il libérait la langueur
humide de ses yeux, gommant un instant leur malice
coutumière. Le cafard le rongeait, qui n’empêcha
jamais ses bouffées d’affection pour ses amis, situation
unique où il s’abstenait ou buvait peu. Non plus
que son humour, bien qu’il n’aimât pas ce mot venu
des Anglais. Il lui préférait l’expression « avoir de
l’esprit » : il n’en manquait pas.
Fidèle à Mistral et aux félibres dont il parlait la langue,
il se régalait d’Alphonse Daudet ou d’Henri Bosco,
ne voyait en Pagnol qu’un bateleur de café-théâtre
auquel, au fond, il reprochait de le faire rire. Ce
déraciné lisait Barrès : l’amour de la terre, le culte des
ancêtres rachetaient à ses yeux les salons parisiens
et l’écriture apprêtée du dandy. Il le rapprochait de
Maurras, dont il était sans doute plus distant qu’il ne
le laissait croire, tout en affichant un monarchisme
suranné.
 Maurras était le penseur politique dont il était le
moins éloigné, bien qu’il n’épousât pas toutes ses
convictions. Il était athée comme son mentor et
anticlérical. Il recevait l’Action française. À cause de la
condamnation du mouvement éponyme par le pape, il
s’y était abonné, en rébellion contre l’Église : jusque-là
il s’était contenté de feuilleter quelques numéros. Il
se délectait des éditoriaux de Maurras, imprégnés de
fierté latine et d’inspiration monarchique. Il appréciait
sa plume polémiste, son élégance de style et sa haine
des Allemands : mais Jules haïssait-il celui qu’il avait
crevé de sa baïonnette ?
Maurras était le penseur politique dont il était le
moins éloigné, bien qu’il n’épousât pas toutes ses
convictions. Il était athée comme son mentor et
anticlérical. Il recevait l’Action française. À cause de la
condamnation du mouvement éponyme par le pape, il
s’y était abonné, en rébellion contre l’Église : jusque-là
il s’était contenté de feuilleter quelques numéros. Il
se délectait des éditoriaux de Maurras, imprégnés de
fierté latine et d’inspiration monarchique. Il appréciait
sa plume polémiste, son élégance de style et sa haine
des Allemands : mais Jules haïssait-il celui qu’il avait
crevé de sa baïonnette ?
Il jubilait de l’ironie et de la cruauté outrancière
d’un Léon Daudet décapant. Il avait souri à lire Les
Morticoles, alors qu’il ignorait le monde cynique de
l’hôpital et de la médecine. La description féroce de la
société ou les portraits littéraires au scalpel donnaient
forme à ce que Jules pensait du monde.
Toutefois, il n’avouait pas de haine des Juifs,
contrairement aux caciques de l’Action française et de
bien d’autres. Or ce n’est qu’après « sa » guerre, qu’il
ne les stigmatisa plus. Auparavant, il avait participé,
qu’il l’admette ou pas, à cet antisémitisme sournois
ou déclaré répandu en Europe. Il cessa après 1918. On
le vit alors glisser dans la conversation des allusions à
l’Étoile de David, qu’une pirouette ramenait au thème
de l’échange. Il semblait s’y accrocher comme un
naufragé à l’épave. Manifestement, évoquer l’Étoile lui
faisait du bien. Nul ne savait pourquoi.
Il était trop jeune au moment de l’affaire pour avoir
été un antidreyfusard militant. Mais avec cette
violence romantique de jeune bourgeois catholique
bien-pensant, il se mêla fiévreusement aux
discussions entre adolescents et bons pères de son
école chrétienne : tous proclamaient la culpabilité
de l’officier juif ; lui le premier, qui manifestait une
brutalité qu’on ne lui connaissait pas.
Mais à la différence des autres, il n’incriminait pas
l’origine juive du capitaine. Sa famille, antidreyfusarde
convaincue, ne se disait jamais antisémite, quoiqu’à
l’église elle fustigeât le peuple déicide. Dans cette
affaire, elle et Jules n’invoquaient devant leurs
interlocuteurs, que le patriotisme et les provinces
perdues qu’on reprendrait. Et faisaient de Dreyfus un
traître uniquement pour ses racines dans une Alsace
germanique, certes française depuis 1648, annexée
au Reich originel : vu de si loin – Sète – ce raccourci
stupéfiant n’était pas inhabituel ; non plus que cette
légende courant en Lorraine après guerre, qui voulait
que les Méridionaux ne se fussent pas battus contre
les Allemands lors du conflit mondial.
Le judaïsme de Dreyfus n’ajoutait donc rien à
l’affaire, disait-on dans la famille de Jules, où l’on
contredisait mollement ceux qui le mettaient en avant.
Que Zola s’en mêlât fut une nouvelle justification
à l’antidreyfusisme de Jules. Il avait en horreur le
populisme du plumitif et son goût supposé pour la
lie de la société : généreux même s’il ne possédait pas
grand-chose, il haïssait le socialisme.
Il garda l’habitude jusqu’à la fin du second conflit
mondial, non pas de fustiger les Juifs, mais de
remarquer qu’Untel devait l’être, du simple fait de
son patronyme, de son emploi ou d’une quelconque
particularité physique soi-disant démonstrative. C’était
d’une terrible banalité, largement répandue, et stupide,
pensait-il, puisqu’elle stigmatisait une population sur
des critères absurdes. Pourtant il continuait. Cette
habitude instinctive, il l’avait acquise, sans aucun
doute, auprès de sa famille, car très jeune il posait
la question : « Cette personne est juive ? ». L’enfant
répétait ce qu’il avait entendu.
Plus jamais il ne voulut formaliser cette question
après ce qu’on découvrit des camps d’extermination.
Il la chassait quand elle lui surgissait à l’esprit, ce
qui restait fréquent, quoi qu’il fît pour en prévenir
la survenue. Il rencontra, à la fin des années
quarante, un médecin au patronyme « évocateur »,
germanophone, descendant d’Alsaciens fixés à Lyon
en 1871 et qui dut exhiber devant la Gestapo la
réalité physique qu’il n’était pas juif, dénoncé par un
condisciple fréquentant la milice et devenu ardent
gaulliste en 1958… Jules n’aimait pas de Gaulle, il
avait été pétainiste : la Révolution nationale était la
seule révolution qu’il acceptait. Mais après le second
conflit mondial, il prit l’habitude, le samedi, d’aller
au centre-ville, au coeur des remparts et de gagner
la synagogue. Il marquait le pas face à l’entrée, se
découvrait un instant et rentrait chez lui. Il n’eut pas
l’occasion de croiser des Juifs et leur Étoile jaune,
pendant l’Occupation : qui sait s’il les aurait salués,
s’il en avait rencontré dans ce village de l’Hérault où il
vécut pendant la guerre ?
Il avait lu Gringoire dès sa création, attiré par sa
critique littéraire et sa ligne politique : l’esprit
« ancien combattant », l’antimarxisme et la haine
de la gauche, puis l’anti-bellicisme qui ne cachait
pas encore le pacifisme, convenaient à Jules,
comme l’antiparlementarisme, après février 1934,
ou l’exécration de l’Angleterre. La haine des Juifs
suspectés de faire le lit du communisme, devint la
litanie du journal, ouvertement antisémite : Jules y
trouvait-il son compte ? Il abandonna la lecture de
Gringoire à l’automne 1940. Il n’en donna pas la
raison. C’était au moment où deux collègues de sa
femme étaient chassés de l’enseignement parce qu’ils
étaient Juifs.
S’il détestait ouvertement les Francs-maçons, il ne
manifestait donc aucun antisémitisme, malgré son
soutien à l’Action française et à Gringoire. Sa femme,
une catholique « sociale », le disait amer de ces
violences de feuille-de-chou : elle ne pouvait imaginer
avoir épousé un antisémite. Il n’adhérait pas non plus
à l’idée commune que les Juifs possédaient l’argent.
Il la trouvait ridicule. S’il méprisait la finance et ses
manipulateurs, qu’ils fussent Juifs ou pas, issus
par exemple de la haute bourgeoisie protestante, ne
l’intéressait pas. Les Juifs ? Il était indifférent à leur
existence en tant que tels. Il était athée et l’argument
du peuple déicide lui était étranger.
Reste que lui, Jules, à Verdun, avait tué un Juif.
Il était antirépublicain et n’aimait pas la démocratie.
Il méprisait politiciens et parlementaires, il détestait
la plèbe capable de guillotiner à tout-va. Il se
reconnut pourtant sans hésitation dans le peuple
de soldats hagards, jetés en pâture aux tranchées,
ses camarades, comme lui, tordus de trouille dans
leurs boyaux infects. Au combat, il s’était senti
parmi les siens : roublards, gueulards, hâbleurs, mais
patriotes, courageux et malins s’il le fallait : lâches ou
poltrons quelquefois, qu’il fallait bousculer ; passifs
en général, sauf à l’assaut où, la peur au ventre,
ils se lançaient à coups de pinard dans la furie. Il
avait dû accepter, comme chacun, la promiscuité des
morts, des vivants et des classes sociales. Lui aussi
s’était jeté à corps perdu dans la bataille, aux côtés
de ses frères. Rien de tel que la peur et la mort sur
ordre, pour parvenir à l’impensable : réaliser ce dont
on s’imaginait incapable : ils le firent, il le fit avec
eux. Les flots de sang, les sanies, les hurlements, les
cadavres putréfiés, l’enfer des obus, de la boue, les
intempéries, les vivants piétinant les morts, les morts
tenant les vivants, rien ne l’avait mieux convaincu de
la folie humaine, sa cruauté et sa passivité, que cet
enfer. Lui-même n’échappait pas à sa propre critique
puisqu’il avait subi comme les autres et s’était tu.
Qu’auraient-ils pu faire ? Sa vie d’après renforça ses
convictions politiques et son hostilité à la guerre,
mais le rendit à jamais indulgent et généreux avec les
malheureux.
Quand on lui rendait visite, il se montrait
accueillant, enjoué et s’exprimait avec chaleur. Il
évitait en général d’étaler ses opinions politiques,
car si la monarchie héréditaire, légitimiste,
antiparlementaire et décentralisée, était son credo,
il en savait la vanité : une utopie pour le plaisir de
s’y accrocher. Conservateur et libéral, rêveur, il
manquait de sens pratique. Ses postures restaient du
vent. Il n’appartenait d’ailleurs à rien ni personne
et ne militait nulle part. Son tempérament ou les
circonstances le forçaient à s’isoler. Il refusa, malgré
des sollicitations de comptoir, de fréquenter les
mouvements d’anciens combattants, les jugeant
populistes et grincheux. Il n’aimait pas les ligues, trop
polémiques ou violentes ; non plus que les fauteurs de
la répression policière du 6 février 34 ou ensuite les
braillards du Front populaire. Quelque pacifiste qu’il
fût, il ne trouvait raison à aucune des vociférations
de la rue. Il ne manifestait pas, ne prenait part à
rien, calfeutré dans l’individualisme où il croyait se
protéger et où quelques vagues camarades de ses
connaissances voyaient de l’égoïsme. Il s’en moquait.
Abordait-on entre amis, ces dimanches soirs où
Joséphine et lui recevaient, la situation du pays, la
littérature, l’histoire, les voyages – lui qui ne voyageait
jamais – qu’il ne montrait à ses invités que bonne
humeur, culture et vivacité d’esprit. Elles faisaient
l’unanimité. Jules n’était jamais si élégant qu’en
parlant sous son faux col rond et son noeud noir,
épinglé d’une abeille d’or. Il pétillait. Il était alors
loin de ses reviviscences morbides. Ses convives les
ignoraient puisqu’il n’en parlait pas. Elles le laissaient
en paix le temps de ces rendez-vous. Sa conversation
raffinée dissimulait un abattement et un pessimisme
qu’on pouvait deviner, mais dont personne n’imaginait
le degré ni l’origine.
Quelquefois la mélancolie le prenait en pleine soirée.
Soudain il s’isolait parmi ses invités auxquels il
échappait. Il se transportait « ailleurs », sans rien
laisser de lui que la gêne provoquée par sa pâleur
soudaine, l’agitation de ses mains et son regard perdu.
Il s’enfermait dans le silence, lèvres entrouvertes,
comme si un mot allait en venir. Il était coupé du
monde, conservant quelques gestes automatiques
et une indifférence à l’entourage qui inquiétait. Il
gardait pourtant mémoire de cette absence qu’il
avait eue. Désorientés s’ils le connaissaient mal, ses
invités s’habituaient à ces changements d’attitude qui
ne duraient pas. Ils lui restaient attachés. Mais une
fois qu’ils s’étaient retirés, après un délai décent les
autorisant à quitter les lieux, il entrait dans une brève
colère. C’était à propos d’un argument qu’il n’avait pas
apprécié chez ses interlocuteurs, que la courtoisie lui
avait interdit de reprendre vertement. Il le ruminait.
Capable de mauvaise foi, il se rattrapait auprès de
Joséphine qui remerciait le ciel d’être sourde : elle
abandonnait son cornet acoustique ou fermait son
sonotone et ne se sentait plus son souffre-douleur.
Cette faculté qu’elle avait de s’isoler de lui, le rendait
furieux, lui qui tant se retranchait des autres.
Rapidement, il abandonnait sa colère, honteux,
cependant incapable de présenter des excuses. Par
orgueil, parce qu’il était convaincu d’avoir raison ; ou
qu’il pensait que s’excuser était inutile et soulignerait
à bon compte le mauvais contrôle qu’il avait eu de lui.
Qu’il pensât avoir tort, il ne l’avouait jamais.
Il préférait retourner à son mutisme, Joséphine se
réfugiant dans son handicap. Il s’enfonçait dans le
silence et finissait la bouteille de Monbazillac ou le
Pommard du dîner. Il fallait attendre le lendemain
midi pour le voir remonter à l’air libre, avec ce sourire
élégant et un peu las qu’égayait avec bonheur sa
moustache blanche : il était rasséréné.
En dehors de ces visites conviviales du dimanche soir,
il se cachait du monde, enfermé dans ses cauchemars.
En ville, durant de longues périodes, il rasait les murs,
tête basse, le chapeau sur les yeux.
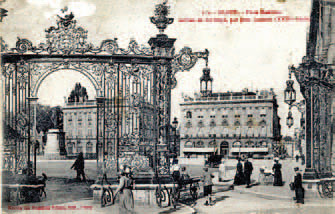 Il sortait à des heures peu fréquentées, craignant la
foule. Il aimait pourtant flâner à Nancy ou écouter
un concert, salle Poirel. Il s’y rendait accompagné :
la présence de sa fille, de sa femme ou d’intimes le
rassurait. S’il y allait seul, il choisissait des horaires
évitant la cohue. Des circuits dans de petites rues le
dispensaient d’emprunter les artères principales. Il ne
passait place Stanislas que tôt le matin, pour goûter
selon la saison, la lumière naissante du soleil ou celles
des réverbères enflammant les façades et les grilles : de
ces feux, quelque chose lui revenait de l’embrasement
matinal du Mont Saint-Clair.
Il sortait à des heures peu fréquentées, craignant la
foule. Il aimait pourtant flâner à Nancy ou écouter
un concert, salle Poirel. Il s’y rendait accompagné :
la présence de sa fille, de sa femme ou d’intimes le
rassurait. S’il y allait seul, il choisissait des horaires
évitant la cohue. Des circuits dans de petites rues le
dispensaient d’emprunter les artères principales. Il ne
passait place Stanislas que tôt le matin, pour goûter
selon la saison, la lumière naissante du soleil ou celles
des réverbères enflammant les façades et les grilles : de
ces feux, quelque chose lui revenait de l’embrasement
matinal du Mont Saint-Clair.
« Il savait La Fontaine et la morale, jouait des mots et
de la clarinette » : c’était le raccourci que feraient un
jour ses petits-enfants. Pour le moment, ils ignoraient
ses sautes d’humeur puisqu’avec eux, il n’en avait pas,
bien qu’ils le fissent enrager, profitant de sa bonhomie
et de sa tendresse infinie. Il arborait le même sourire
lorsqu’il leur récitait les fables qu’il savait en nombre.
Il insistait sur la morale qui les concluait, du ton d’un
austère pédagogue ; puis la déguisait soudain en un
propos absurde et drôle. À l’occasion, il donnait de
courtes fables de son cru. Il rimait assez bien. La
chute en était toujours drôle ou inattendue, jamais à
rebours.
Ailleurs, ses traits d’esprit pétillaient, ironiques ou
amusants, parfois cruels, fusant devant quelques
initiés auxquels il les réservait. En regard, ses piètres
jeux de mots pâlissaient, insupportables et à la
chaîne, lors des périodes d’exaltation qui suivaient des
semaines d’abattement. Ils étaient alors le paravent le
protégeant de sa mélancolie. D’ailleurs ils laissaient
percevoir sa vieille langueur à qui savait la deviner.
Jules aimait l’Histoire, malgré l’inutilité de ses leçons.
Il en racontait de brefs épisodes à ses petits-enfants,
choisis et orientés – nos grands rois, les cathédrales,
Jeanne la Lorraine – et les accommodait à sa façon. Il
rendait drôles les épisodes les plus cruels, brouillait les
faits et les époques, pour le plaisir : les rois fainéants
en wagon-lit précipitaient les enfants à la fenêtre pour
guetter la gare voisine et le Train Bleu. Il inventait
ou mêlait contes et personnages illustres. Racontait
l’Ancien régime, superbement ignorait la République.
Contrairement à Paul Valéry, son aîné à Sète, il croyait
à la répétition de l’Histoire, dont il s’inquiétait. Il
craignait les révolutions, abhorrait la violence. Il
haïssait les Jacobins et ces « votants », comme on les
appela, qui, par leur choix, avaient tranché et mis à
mort Louis XVI. Pour un anniversaire, Joséphine lui
offrit une biographie de Robespierre, croyant lui faire
plaisir. Il partit dans une colère noire et mit le livre
en morceaux. Elle cessa de lui faire des cadeaux et
attendit qu’il agonisât pour baiser son front et lui
demander pardon de ses incompréhensions : elle était
sincère et bonne chrétienne.
Un jour que les petits voulurent l’interroger sur
sa guerre, il fut épouvanté. Ses cheveux blancs se
dressaient sous leurs boucles. Il s’agitait, quitta sa
chaise, précipitait de courts allers et retours dans
l’étroite cuisine chauffée au bois ; se rassit, se
dressa encore, vint à la fenêtre, regagna son siège.
Les petits riaient de ce burlesque, croyant à un jeu ;
puis s’interrogèrent : la partie était bien longue. Ils
percevaient quelque chose de trouble qui les gênait.
Leur grand-père s’assit lentement, baissa la tête,
rentra le menton sous sa moustache et leur dit que ce
sujet n’était pas de leur âge. Ils le prirent pour argent
comptant et l’on joua au Nain jaune.
Dès 1919, il retrouva l’élégance et sa distinction
d’avant-guerre, que les tranchées avaient estompées
sans les effacer : son maintien, son tempérament,
malgré la boue et les horreurs, y avaient gardé assez
de chic pour qu’on le respectât comme un seigneur, lui
qui était caporal. Ses peurs, puis l’usure des excès et
de l’âge, n’eurent jamais raison de sa tenue, même s’il
était éméché. Aidé de sa petite taille, avec le temps,
il filait lentement dans l’ombre, avec cette assurance
qui vous glisse aux Enfers. Les décennies passantes,
il se voûtait. Ses genoux fléchissaient. Il allait le cou
tendu pour dresser la tête. La souffrance, la douleur
se lisaient dans son regard bleu et humide comme
l’eau où l’on se noie. Il s’affaissait, écrasé par le
fardeau de la vie. L’insomnie le disputait à ses peurs
du crépuscule. Lui, autrefois trapu, devenait frêle et
fragile : le chêne se faisait brindille que Jules écrasait
de son propre pas.
Si les cauchemars le tuaient, ses rêves l’aidaient à
vivre.
 Il était friand de Suze, qu’il
dégustait au Café du canal, à
Toul, les après-midi d’hiver.
La gentiane sombre, épaisse,
tandis qu’il buvait, déposait
de fines perles d’or sur sa
moustache. Un instinctif
jet de langue les plaquait
sur le palais. Le nom de
la liqueur et sa couleur
éveillaient des images de
route de la soie. Il passait
Istanbul, Tabriz, gagnait
Ispahan ou Samarkand,
contemplait le turquoise des dômes, découvert chez
Loti. L’illustration lui livrait des récits de voyage en
Asie centrale ou en Perse ; les photos en noir et blanc
ou des gravures de couleur, restituaient les images et
suggéraient les parfums du port de Sète, à l’époque de
sa splendeur, quand, enfant, il rêvait d’Orient.
Il était friand de Suze, qu’il
dégustait au Café du canal, à
Toul, les après-midi d’hiver.
La gentiane sombre, épaisse,
tandis qu’il buvait, déposait
de fines perles d’or sur sa
moustache. Un instinctif
jet de langue les plaquait
sur le palais. Le nom de
la liqueur et sa couleur
éveillaient des images de
route de la soie. Il passait
Istanbul, Tabriz, gagnait
Ispahan ou Samarkand,
contemplait le turquoise des dômes, découvert chez
Loti. L’illustration lui livrait des récits de voyage en
Asie centrale ou en Perse ; les photos en noir et blanc
ou des gravures de couleur, restituaient les images et
suggéraient les parfums du port de Sète, à l’époque de
sa splendeur, quand, enfant, il rêvait d’Orient.
Lorsque son esprit s’évadait, – les seuls grands
voyages qu’il fit jamais – ou lors de ses retours
réguliers à Sète, il échappait aux horreurs qui
le minaient. Il était pleinement sur sa route, rien
n’existait plus de sa morosité. Mais le crissement
d’un caillou, le craquement d’une barque au soleil,
réveillaient son angoisse ou pire, ressuscitait la scène
originelle, au détail près. Avec le temps et l’âge, elle
devint moins violente, les images se firent plus floues.
Elle surgit moins souvent, gommant ses contours
tandis que demeurait l’Étoile de David, qui jamais ne
manqua. Jules s’accrochait à ses branches pour ne
pas se perdre. Elle le protégeait, il se sentait moins
durement soumis aux affres de la mémoire.
Les derniers mois de sa vie, il somnolait à sa tablebureau,
la tête sur ses longues mains osseuses,
sillonnées de lourds cordons veineux, posées à plat,
qu’il croisait sous son front. C’est alors qu’il se mit
à parler dans un demi-sommeil, devant ses proches
dont la présence lui échappait. Il soliloquait d’une
voix étreinte que brisait son souffle de cardiaque.
On suspendait ses jeux, sa lecture, son tricot ; on
s’arrêtait pour l’écouter, fouillant chaque murmure
pour y trouver sa vie. Il révélait dans la confusion
son combat singulier avec l’Allemand ; il le répétait
à la lettre le lendemain. Sa famille ébahie après des
décennies de silence, en recueillait le témoignage. Son
frère Gabriel le confirmait à chacun puisqu’il l’avait
su sitôt la guerre finie, mais s’était tu, comme promis.
Jusque-là, à sa femme et sa fille, Jules n’avait dit que
« sa lutte à couteaux tirés avec la mort », souvent
en riant, un rire qu’a posteriori on trouva amer. Des
années durant, elles avaient cru à une métaphore qui
devenait lassante et les agaçait. Elles n’avaient pas vu
ce que Jules y cachait en lui.
Ses camarades d’âge, forcés à la même retenue, ne
disaient rien non plus de leur guerre. Elles le savaient
et ne se formalisaient pas de ces silences ; jusqu’à ces
révélations dans un demi-sommeil. Aussi suffisait-il
à Jules que les évènements eussent bien tourné : il
était en vie, c’était beaucoup, inutile d’en rajouter.
Mais quelle vie ? C’était son affaire à lui seul… Et dans
ses troubles de l’humeur et du sommeil, ses proches
se contentaient d’incriminer les prises d’alcool,
irrégulières et répétées.
Assourbanipal, Darius, Alexandre le grand, Marco
Polo l’avaient promené très jeune, quand il s’asseyait
en haut de la colline, à regarder la mer, près du
Quartier-Haut. Ces figures maintinrent, sa vie entière,
la mémoire de ses désirs anciens, quand jaillissait de
sa clarinette, une musique aiguë ou grave, souple,
profonde et lointaine. Elle lui venait d’Aden, de
Damas, de Bagdad ou d’ailleurs, sous les embruns du
vent marin, mais naissait dans ses entrailles. Il aimait
certaines pièces accompagnant la liturgie ashkénaze,
qu’il interprétait dans un recueillement qu’on ne lui
connaissait pas ailleurs. Sinon sa musique prenait
l’acidité des hautbois qui aiguillonnaient les rameurs
de son enfance, lors des joutes sur le grand canal,
quand ses cris depuis la berge, encourageaient les
chevaliers dressés sur la poupe, la lance sous le bras,
l’écu au coude, large ceinture de coton, rouge ou
bleue, prêts à s’affronter dans la lice des eaux marines.
Ils se battaient pour la belle des troubadours qu’on lui
faisait lire.
 En dehors de ses voyages imaginaires, l’autre joie
capable de passer sa mélancolie, était la musique.
Sa clarinette le protégeait de ses craintes ou de ses
obsessions. Sous ses doigts, Mozart, Weber, Brahms
charmaient les serpents qui étouffaient sa vie. Il
jouait seul, parfois avec des amis. Il retrouvait sa
courtoisie et son humour d’antan. Quand Alexandre
le rejoignait avec son cornet à pistons, Jules jubilait.
Leurs poitrines de sonneur explosaient en rires
olympiens. Ils balançaient la musique, dans leur tête
ils dansaient. Ils la puisaient dans les fonds abyssaux
de leur poitrine et quelque flacon de fine. La portaient
au ciel comme une offrande aux dieux. Posant
leurs instruments, ensuite ils chantaient, réveillant
les vivants – Joséphine et leur fille, Marthe l’épouse
d’Alexandre, les voisins – comme à l’Hôtel-Dieu, les
chants des salles de garde endorment les morts. La
nuit s’effaçant, leurs soupirs de bonheur saluaient
l’aube glacée et le lever du soleil.
En dehors de ses voyages imaginaires, l’autre joie
capable de passer sa mélancolie, était la musique.
Sa clarinette le protégeait de ses craintes ou de ses
obsessions. Sous ses doigts, Mozart, Weber, Brahms
charmaient les serpents qui étouffaient sa vie. Il
jouait seul, parfois avec des amis. Il retrouvait sa
courtoisie et son humour d’antan. Quand Alexandre
le rejoignait avec son cornet à pistons, Jules jubilait.
Leurs poitrines de sonneur explosaient en rires
olympiens. Ils balançaient la musique, dans leur tête
ils dansaient. Ils la puisaient dans les fonds abyssaux
de leur poitrine et quelque flacon de fine. La portaient
au ciel comme une offrande aux dieux. Posant
leurs instruments, ensuite ils chantaient, réveillant
les vivants – Joséphine et leur fille, Marthe l’épouse
d’Alexandre, les voisins – comme à l’Hôtel-Dieu, les
chants des salles de garde endorment les morts. La
nuit s’effaçant, leurs soupirs de bonheur saluaient
l’aube glacée et le lever du soleil.
L’Allemand ne troublait jamais leur joie de carabins.
Il aimait par-dessus tout partager la musique avec
sa fille, jeune pianiste préparant le conservatoire.
Elle l’accompagnait et rendait heureuse la sérénade.
Des heures ensemble, ils déchiffraient, jouaient et
rejouaient. Sa tristesse, son désarroi, sa mélancolie
fondaient. Quelquefois surgissait une inquiétude, un
déclic. Les mesures suivantes sonnaient moins bien, le
rythme était rompu. Ils reprenaient, recommençaient,
corrigeaient, se désaccordaient. Jules ne suivait plus,
s’irritait contre lui puis contre elle. L’adolescente
voulait prolonger la séance, faire durer ce moment où
son inquiétude rejoignait l’angoisse de son père. Elle
savait trop que c’était « cette même chose » qui faisait
irruption dans son crâne. Mais laquelle ? Elle aurait
tant aimé savoir. Il ne tarderait pas à sortir, elle le
craignait et reviendrait éméché.
Le lendemain, il pleurerait dans ses bras.
Après sa drôle de guerre, il s’était donc fixé à Toul. Il
y vécut trente-huit ans, à l’écart des notables. Il sortit
peu, ne fréquentait personne en dehors de quelques
collègues de sa femme ou de leurs amis du dimanche
soir, d’épisodiques relations professionnelles et de
deux ou trois bistrots. À soixante-seize ans, il rentrait
au pays. Mais il abandonnait l’idée de s’installer à
Sète. Il la délaissait, il n’y avait plus de nid. Aux
crochets de sa femme depuis des années, il s’exilait
dans un village qui n’était pas le sien, à huit lieues de
là. C’était celui de Joséphine et c’était sa maison à elle,
on le lui rappellerait assez. Son frère et ses neveux y
étaient installés depuis des lustres, qui compensèrent
la douleur de l’exil. Ils prospéraient autour de vignes
dont il avait sa maigre part. Ils furent son unique
réconfort tandis qu’il languissait dans ce trou.
En 1920, au milieu de palabres jalouses et d’augures
pessimistes, on y avait arrangé son étonnant mariage
– une mésalliance, les proches des deux familles le
rabâchaient – avec une sainte femme, certes, mais
laïque et républicaine, disciple de Jaurès plus que
de Barrès, alors que chez Jules on était royaliste et
catholique ultramontain. Cultivée, belle, sans une once
de méchanceté, elle était une intellectuelle et il est
vrai, grenouille de bénitier. Les prétendants n’avaient
guère été nombreux malgré leurs qualités et les
siennes. Elle les avait repoussés. Pourquoi elle accepta
Jules, malgré les mises en garde, reste un mystère. Elle
enseignait au lycée, pas à l’École libre, par conviction
et pour son père, vieil élu radical-socialiste. Sa foi
sincère et généreuse, venait de sa mère morte jeune
qui n’avait attendu de la vie que le paradis éternel.
Comme elle, Joséphine l’avait vissée au coeur. Jules,
trente-sept ans, elle, vingt-huit, avaient en commun
l’essentiel. Le futile ou la fantaisie leur manqua. Jules
y était enclin, elle les dédaignait comme on repousse
le péché : jamais ils ne s’entendirent.
Il haïssait ce village où, de l’automne 1940 à l’été
44, il avait souffert des moqueries d’une belle-famille
donneuse de leçons : à la propriété de son frère, il
avait remplacé ses neveux, prisonniers outre-Rhin.
Il avait laissé sa femme et sa fille de vingt ans à
Toul, en « zone interdite », abandonnées dans leur
immeuble peuplé de soldats Allemands, jusque dans
leur appartement. Il avait agi par devoir, disait-il, ne
se souciant guère de celui de chef de famille. Il se le
reprochait moins qu’on ne lui en voulait au village.
Personne ne soupçonnait qu’il fuyait une nouvelle
fois l’Allemand et cette Étoile juive, que dans ses
rêves, ensuite, il vit jaune ; et non plus au cou mais
sur la vareuse du malheureux, barré du mot « Juif » ;
ni que sa désertion n’était qu’une tentative de plus
d’échapper à son cauchemar. Ce ne fut d’ailleurs
pas le cas : on le croisait pompette, quelquefois
ivre. Il était la cible des quolibets qu’il recherchait
pour se mortifier ; et du mépris haineux de sa bellefamille
qu’il détestait. Sa honte grandissant, il buvait
davantage. Il était l’épicentre de ce chaos familial.
Le voici donc échouant en 1959, Joséphine en retraite,
dans un site qu’il n’aimait pas. Il laissait la Lorraine
à laquelle il s’était attaché et la colline de Sion, cette
« colline inspirée », posée sur sa mer de verdure
comme un « mont Saint-Clair au beau milieu des
prés », disait-il aux Sétois qui lui rendaient visite.
 Quitter la Lorraine, un nouvel abandon. Il ne pouvait
rejoindre, dans l’immédiat, le Cette de son enfance.
À cause de cette dépendance à sa femme, aussi parce
qu’il ne le voulait pas, c’était trop tôt. Il n’était pas
prêt. Il savait que le temps venu, il s’y rendrait.
Il attendit cinq longues années dans cet exil, à guetter
l’heure de sa renaissance : ce serait au dernier souffle,
à l’occasion de son transfert à l’hôpital de Sète.
Son séjour au village fut d’une tristesse plus cruelle
qu’à l’ordinaire. Ses cauchemars le réveillaient
plusieurs fois par semaine, puis s’espaçaient avant de
revenir, plus fréquents. Ils se faisaient moins violents.
Ou il les supportait mieux, comme si, avec l’âge,
ses sens s’émoussaient. En revanche, ils duraient
davantage et se répétaient dans la journée. Cinquante
ans après le drame, les détails restaient intacts. Il
ne s’en perdait aucun, malgré le flou des images.
Jusque-là, Jules avait masqué tant bien que mal son
anxiété et sa mélancolie dans d’incertains excès de
vie, stigmates probables de l’engouffrement futur.
Désormais, il les exhibait à l’état pur, le masque
était tombé : il était vieux, malade, infirme. Les
rhumatismes déformants et la défaillance cardiaque
avaient raison de sa carcasse. Pas l’alcool, ou pas
directement, c’était sans importance.
Quitter la Lorraine, un nouvel abandon. Il ne pouvait
rejoindre, dans l’immédiat, le Cette de son enfance.
À cause de cette dépendance à sa femme, aussi parce
qu’il ne le voulait pas, c’était trop tôt. Il n’était pas
prêt. Il savait que le temps venu, il s’y rendrait.
Il attendit cinq longues années dans cet exil, à guetter
l’heure de sa renaissance : ce serait au dernier souffle,
à l’occasion de son transfert à l’hôpital de Sète.
Son séjour au village fut d’une tristesse plus cruelle
qu’à l’ordinaire. Ses cauchemars le réveillaient
plusieurs fois par semaine, puis s’espaçaient avant de
revenir, plus fréquents. Ils se faisaient moins violents.
Ou il les supportait mieux, comme si, avec l’âge,
ses sens s’émoussaient. En revanche, ils duraient
davantage et se répétaient dans la journée. Cinquante
ans après le drame, les détails restaient intacts. Il
ne s’en perdait aucun, malgré le flou des images.
Jusque-là, Jules avait masqué tant bien que mal son
anxiété et sa mélancolie dans d’incertains excès de
vie, stigmates probables de l’engouffrement futur.
Désormais, il les exhibait à l’état pur, le masque
était tombé : il était vieux, malade, infirme. Les
rhumatismes déformants et la défaillance cardiaque
avaient raison de sa carcasse. Pas l’alcool, ou pas
directement, c’était sans importance.
Son corps écrasé, impuissant, se desséchait, tandis
qu’il s’abandonnait lui-même. Cellule après cellule,
sa chair revivait les blessures accumulées depuis la
mort de l’Allemand. Ses traits se tordaient comme
ceux de ce malheureux, expirant sous ses yeux à
la cote 304, dont il fut la victime sa vie durant. Car
c’était l’Allemand qui avait gagné le combat et qui se
vengeait : il lardait Jules de coups de baïonnette, lui
déchirait les tripes. Les douleurs abdominales étaient
de plus en plus fréquentes, « comme des coups de
couteau » disait-il au médecin impuissant, qui jamais
ne fit le diagnostic. Et le Prussien continuait de la
désarticuler, lui tordant les os, d’étouffer son coeur et
d’infester son esprit.
Sa tête lui faisait mal. Son front blanc et veineux se
ridait d’idées sombres, puisées, non dans l’alcool,
comme on le disait, mais dans ce corps à corps
interminable ; non pas celui de Job avec l’Ange, mais
celui de Goliath mort et qui l’emportait à jamais
sur David resté en vie. Comme pour empêcher ce
poison de l’emporter, tandis qu’il somnolait, ses
doigts noueux s’accrochaient à la table où il reposait
son crâne, comme à une bouée. Ce repos de façade
escamotait un instant le retour de l’Allemand.
Près de Jules, comme une sentinelle, un gros oignon
d’argent écoulait les secondes. Il s’enchaînait à son
tic-tac. Il en comptait les coups, jusqu’à s’endormir.
Ses faibles yeux fouillaient la ronde des aiguilles,
guettant la fuite des heures, qui finiraient par
l’entraîner. De gros chiffres romains sur le cadran,
encerclaient le temps, comme des Légions assiégeant
l’oppidum. Il était prisonnier. Prisonnier du temps, de
sa guerre. Prisonnier de l’Allemand.
Dans la journée, la TSF grésillait à son oreille. Ses
doigts gourds traquaient fébrilement les stations
et le son. À l’annonce d’un passage musical qu’il
attendait, par crainte d’une trop forte émotion, il
baissait la puissance, afin d’entendre moins.
Ou, d’un geste, interrompait sa quête de musique
ou d’Histoire. De dépit. À cause d’un propos qu’il
refusait. L’exaspération lui faisait rompre l’écoute d’un
monde qui n’était pas le sien. Ses fidélités surannées
tombaient sous les coups d’une morale à rebours,
celle d’une humanité nouvelle et sauvage, burlesque,
irrespectueuse, qui osait faire la leçon aux êtres
policés.
L’Allemand et lui étaient les ultimes rejetons de la
civilisation. Quand il aurait lui-même disparu, ce serait
le chaos et le monde d’hier ne serait plus.
Le dimanche soir, depuis ces années que Jules
déclinait, son frère Gabriel lui rendait visite. Il
s’asseyait en face de lui, à le toucher, dans la
pénombre de la vieille bâtisse, fuyant le jour moribond
et baissant le lampadaire. Il tenait près du sien son
visage émacié, rosi par la tramontane ou la marche
pressée à travers le village. Ses traits finement ciselés,
contrastaient avec ceux de Jules, bouffis d’oedème et
pâles. Il était passé par l’église, s’y était recueilli. Il
avait prié pour son frère, hostile aux bondieuseries,
auquel il cachait prier aussi pour l’Allemand juif.
Jules n’y entrait jamais, Gabriel chaque jour. Celui-ci
se confessait au prêtre, Jules à son frère. Il ne lui
cachait rien. Gabriel, depuis longtemps, connaissait
l’Allemand et les cauchemars de Jules. Il avait cessé
de l’exhorter à se rapprocher de Dieu, seul espoir de
calmer sa souffrance. C’était inutile. Jules n’en voulait
pas : Dieu n’était pas mort, puisqu’il n’existait pas.
Cravaté de sombre, col blanc épinglé avec goût, gilet et
pantalon rayés, veston noir, Gabriel, chaîne et montre
au gousset, ressemblait encore au Jules des années
fastes : à peine moins fort de visage, mêmes regard
et vêtements démodés. Il y avait de la distinction
chez ces deux frères, celle des bourgeois éduqués des
années vingt où ils semblaient s’attarder, quand en
affaires, Gabriel se montrait déjà plus adroit et rusé
que Jules. Un Jules qui désormais dégringolait, ne se
cramponnant plus à rien qu’au temps qui finissait…
Après les embrassades d’usage, tenant du respect
et de la retenue plus que de l’affection, l’entourage
s’éclipsait. On les laissait seuls dans la pénombre
qu’esquissait une faible ampoule sous son abat-jour.
Le naturel de ce couple imposait qu’on fût discret. On
respectait ses chuchotements, des messes basses qu’on
raillait en cachette. L’irruption d’un quidam, fût-ce un
proche, les faisait taire. Où changer de sujet, qu’un
instant, par courtoisie, ils étendaient à l’intrus.
Gabriel animait la conversation. Sa voix étouffée,
sourde et qu’il forçait, sa parole ferme et mesurée,
choisie, son visage d’oiseau, ses traits vifs, sa brève
moustache par-dessus sa vêture surannée, évoquaient
Mauriac ; une allure qu’avait partagée Jules et qu’il
laissait filer, lui si raffiné, si distingué, qui abandonnait
superbe, tenue et maintien pour s’enfermer dans
l’aigreur de la rumination. Entre ces deux semblables
qui tant différaient désormais, le ton restait pourtant
à la confidence. Ils gardaient intactes l’affection et la
confiance.
Jules, un instant, se requinquait auprès de ce frère qui
le suivrait de peu dans la tombe.
Pas un jour ne coulait sans qu’il visitât Eugène le
cordonnier voisin. L’atelier était à deux maisons de
celle de Joséphine. Jules ne possédait rien, sauf des
dettes que sa femme et peut-être son frère, éclusaient
encore. Sans attaches ni biens dans cette bâtisse, il
n’était pas à l’aise entre ses murs épais. Il n’aimait pas
cette geôle. Il se préférait chez Eugène.
Comme beaucoup de savetiers, il était estropié : un
pied-bot jamais soigné. Chemise noire blanchie de
crasse, béret à plat sur un crâne dégarni, petit, râblé, il
était adroit comme un clown lorsqu’il se déplaçait avec
ses cannes. Son visage avait le sourire et les lunettes
de Chabrol, yeux écarquillés, jovialité et bavardage
garantis.
Jules et lui échangeaient leur misère. L’artisan était
assis sur son tabouret. Le marteau à la main et dans
l’autre le soulier, il agitait ces marionnettes devant
grand rideau du tablier de cuir qui le protégeait.
Eugène travaillait. Il parlait comme un ventriloque,
bouche fermée, serrant entre ses dents des clous tirés
d’une boîte de métal, dont les têtes ourlaient ses
lèvres. Jules s’asseyait face à lui, sur une chaise de
paille, après qu’il eut franchi les deux marches de
l’échoppe encombrée et sale. Il s’imprégnait de l’odeur
fade de la poix ou de celle de vieilles peaux tannées,
pendues comme des trophées. Ne se racontant rien, ils
se disaient tout, tendant l’oreille que Jules élargissait
d’une paume pour entendre, il devenait sourd. Ils
transformaient en épopées les évènements du village,
que colportaient des commères confiant les chaussures
à réparer.
Jules redoutait le crissement de l’outil sur le cuir,
de crainte que l’Allemand ne se joignît à eux. Il
vient quelquefois. Pour lui interdire d’apparaître, il
avalait un verre de vin ou d’anis, ou deux, ou plus.
Ils rendaient incertain son retour à la maison. De la
réprimande conjugale, il ne se souciait pas. Elle ne
venait qu’après, compensée avec bonheur par le plaisir
qu’il avait eu auprès d’Eugène.
On approchait du printemps 1964. Ce jeudi-là de mars,
le temps avait tourné. La neige tombait à gros flocons.
Elle étouffait le grondement des vagues sur la grève
et le bruit de la ville. Sète était assommée. Comme
l’assourdissement après le tir du canon, un silence de
glace s’installait. On entendait à peine le brouhaha des
conversations de la population transie. Elle n’avait pas
l’habitude. Elle avait peur.
La ville était figée. Voitures, autobus, carrioles,
camions se mettaient en travers dans la poudreuse. On
suffoquait sous les gaz d’échappement. Errant dans
cet imbroglio boréal, courageux ou curieux tentaient
une sortie. Ils glissaient d’un bord à l’autre de la cité,
dans le chuintement de leurs pas incertains. Rompue
de chutes, emmaillotée comme des poupées russes, la
foule était effarée.
Paralysée par l’intempérie, son coeur cessant de
battre sous les coups de la tempête, Sète, asphyxiée,
accompagnait Jules : il avait une attaque, elle lui offrait
la sienne. Ensemble ils tombaient, se relevaient, à
chaque chute un peu moins, deux moribonds
s’étreignant, leurs mains entremêlées.
Sur la corniche enneigée, la muraille lugubre du
vieux Lazaret dominait la mer ; le vilain clocher de
sa chapelle, morne et sombre, achevait cette vue de
Lorraine en décembre. Tout était gris : l’eau, le ciel,
la pierre. On avait transféré Jules dans ce réduit au
pied du Mont Saint-Clair, à l’écart du centre-ville, un
mouroir. Muet derrière son masque flétri, il dormait,
la tête en extension. Sur l’oreiller, son visage perdait
ses rides, gonflé d’oedème, comme rajeuni. Il avait
la bouche tordue, grande ouverte par-dessus le drap,
édentée : il n’avait plus son appareil. Ses lèvres
amincies se renfrognaient sur les gencives nues. Son
menton fuyait et son nez se pinçait. Ses yeux mi-clos
étaient vides, deux globes absents du monde, comme
s’il regardait du dedans son propre souffle, chassé de
sa poitrine.
Les murs de la salle commune, badigeonnés de laque
verte et criarde, étaient percés de fenêtres à la hauteur
insensée. Le plafond sale s’effritait. Dans cette pièce
odieuse, agonisait le corps à corps de Verdun. De
derniers soubresauts tentaient l’impossible. Il n’en
resterait rien.
Le grincement de la porte ne déclencha pas de
réminiscence, ni le suivant, ni aucun autre. Enfin
Jules se débarrassait de son obsession. Son cauchemar
s’échappait à toutes jambes, comme s’il fuyait la mort.
L’Allemand avait disparu, en fuite lui aussi. Plus rien
ne le ferait revenir. C’était fini. Enfin ! C’était fini !
Jules trouvait la paix oubliée à Verdun, celle de sa
jeunesse. Il redevenait un homme. Il n’avait plus
peur de rien, ne rasait plus les murs, n’avait plus soif.
Ses angoisses fondaient. L’alcool serait inutile. Il ne
chancellerait plus. Il avait quatre-vingt-un ans pour
l’éternité, un si jeune âge : il n’en démordrait plus.
L’épaisse couche de neige recouvrit jusqu’au perron
de ce dortoir-prison. D’autres agonisants s’en allaient
avec lui, tués par les guerres ou la vie. La bourrasque
soufflait, gommant les pas de ces demi-fantômes sur la
neige. Aucun ne laisserait sa trace, Jules pas plus que
les autres.
Il se crut un moment remis des douleurs qui le
broyaient ou de cet oedème qui lui gonflait le coeur.
L’étincelle ralluma sa paupière, passa la lueur paisible
du juste. Libéré, Jules devinait la présence des siens ;
peut-être souriait-il. Il respira un grand coup, rouvrit
ses yeux sur le monde, naquit une deuxième fois.
L’espace d’un instant, il vit défiler sa vie entière.
D’un regard élevé et fier, il salua et mourut.
Le lundi, au petit matin, les clartés aiguës et sèches de
la mi-mars estourbirent l’hiver. La neige avait fondu.
Le mistral vidait de ses étoiles la nuit décomposée. Le
soleil dégoulinant de lumière, pointait sur l’horizon. Il
fendait le dôme noir qui recouvrait la mer. Il embrasait
les phares sur les jetées, les ferrailles engourdies sur le
port et la flamme sombre des cyprès sur les tombeaux.
Il éclaboussait le marbre et le calcaire du cimetière, les
chauffait dans l’étreinte.
Aujourd’hui, solennel, Jules entrait au Quartier-Haut.
Le temps l’avait rattrapé : il était venu sans qu’ait
jamais faibli son désir d’y résider. Il avait pris cette
décision, enfant : l’heure venue, il s’installerait dans
l’allée du haut. Juste au pied du phare d’où il veillerait
les navires.
Il jouait alors dans le Cimetière marin avec ses
camarades, à l’insu des parents. Ils se cachaient entre
les sépultures ; à cheval sur un bâton, galopaient dans
les escarpements. Sans piailler, ils s’amusaient dans
ce labyrinthe d’escaliers, d’entrelacs ou raidillons.
Ils parlaient à voix basse, assis sur les terrasses que
leur faisaient les margelles bordant les tombes. Ils
n’avaient pas un cri, à peine si leurs pas frôlaient le
gravier. Le silence était leur jeu. Jules qui était bavard,
y savait se taire.
Il apprenait, puis se récitait, gravées dans la pierre
funéraire, des litanies de noms et de dates, ceux de sa
famille et d’autres, la plupart oubliées. Il y voulait le
sien. Il examinait ces petits portraits sépia, figés dans
l’émail, tirés d’anciennes photographies, qu’on posait
sur les tombes. Dans la chapelle familiale, on n’en
voulait aucun ; il ne mettrait pas le sien : le patronyme,
le prénom, deux dates – 1883 et ?? – suffiraient à la
désigner, lui, le mort sans portrait. Il les fera graver à
l’avance ; ne restera qu’à inscrire la date de sa mort.
Les gamins profitaient des terrasses du cimetière,
chauffées au soleil. Les cyprès, les lauriers, les pins
par-dessus les marbres, le thym entre les rocailles,
exhalaient leur parfum de garrigue : la mort, ici,
embaumait les vivants. L’été, on vibrait du chant des
cigales, inconsolables pleureuses. Quelques diadèmes
séchés se fichaient autour des croix, comme le grand
cordon d’un Ordre millénaire : Petit-Jules se voyait
maréchal ou poète. D’autres couronnes, de céramique
multicolore comme des fruits confits, à plat sur la
dalle des tombeaux, l’invitaient au festin de dieux
épiphanes.
Tout en haut, de l’autre côté du mur, enfouies sous le
maquis, des villas se mêlaient aux « baraquettes », ces
cabanons du cru où jadis, les dimanches s’écoulaient
dans la joie. On faisait griller le loup ou la sardine,
mijoter la bourride. Le vin rafraîchissait entre des
barres de glace, à l’ombre des pins. Exclues de ces
agapes, les femmes en étaient le coeur. Les hommes
et leurs vieilles complaintes ne louaient qu’elles.
Adolescent, Jules chantait avec eux mais préférerait
les fêtes de Pointe-Courte et sa belle Italienne. Les
mélodies napolitaines le faisaient soupirer.
Ce matin, derrière Jules, le cortège des vivants montait
entre les tombes, glissant sur les cailloux, tandis que le
soleil escaladait le ciel.
Jules allait avec lenteur. En prince, il gravissait la
pente où gisent les tombeaux, carré après carré. Ses
sujets lui faisaient procession. En charge du protocole,
le prêtre, devant le cortège, tenait la croix, convoqué
par Joséphine : elle avait enfin raison de son mari
athée, il lui laissait le dernier mot. Son étole violette,
dans le vent, faisait bannière. La lumière montait des
eaux. Elle inondait le cortège où les jeunes s’agitaient
et chuchotaient les autres. L’enfant de choeur balançait
l’encensoir dans les rais du soleil, s’amusant des
éclairs fusant sur Jules et sa suite.
Dans le silence, perçait le cri des mouettes envolées
jusqu’à lui. Ce matin elles abandonnaient la criée et
venaient le saluer. On distinguait des sanglots étouffés
ou de brusques éclats de rire, sitôt réprimés. Des
tombes, montait le cantique que lançaient les choeurs
aux cieux : Jules était de retour. Alors s’ouvrirent
les sépulcres libérant leurs esprits. Des camarades
d’enfance, morts avant lui, venaient au-devant de leur
compagnon. On l’acclamait du canal au cimetière, du
port jusqu’en mer. Défilaient à ses pieds des colonnes
de mâts et de voiles, de caboteurs ronflants, dans le
raffut des trompes et des cornes de brume.
Au loin, une clarinette sonnait « Aux morts ! »
L’abandon de sa chair dans la crypte familiale,
apaiserait cette vieille âme ombreuse. Elle gagnerait,
tranquille, le calme des dieux. Le grand tombeau
ouvert, dans le mouvement des cordes qui tenaient
le cercueil, Jules glissa vers les siens qui l’attendaient
en bas. Il tourna ses yeux vers l’éclatante lumière et
reconnut sa mer.
Dessus, rougissant la surface, flottait le corps
ensanglanté de l’Allemand.

MGI (2eS) François Eulry
